
Subscribe & stay up-to-date with ASF

Un jour de 2012, Karen Dunmall a ouvert son courrier pour y trouver un colis qui l’attendait – à l’intérieur se trouvait la tête d’un saumon.
Recevoir des têtes de poisson par la poste est, pour être clair, une routine pour Dunmall. Étudiante en doctorat à l’université du Manitoba, Mme Dunmall dirige l’Arctic Salmon Project, une initiative de recherche visant à documenter la prévalence accrue du saumon du Pacifique dans l’ouest de l’Arctique canadien, où le saumon est historiquement rare. Les pêcheurs de subsistance reçoivent des cartes-cadeaux de 50 dollars en échange de leur saumon – le corps entier ou seulement la tête – que Dunmall examine à la recherche d’indices susceptibles de révéler l’origine du poisson. Elle analyse la composition chimique des os de l’oreille pour déterminer les eaux d’origine et passe au crible les contenus stomacaux pour déterminer les régimes alimentaires. Elle a également élaboré un guide du saumon du Pacifique pour aider les pêcheurs à identifier leurs prises inhabituelles.
« Je me promène dans l’Arctique et les gens ne connaissent même pas mon nom », dit Dunmall en riant. « Ils m’appellent simplement la dame au saumon.
Ce qui a rendu la livraison de 2012 inhabituelle, ce n’est pas qu’il s’agissait d’une tête de saumon, mais d’une tête de saumon de l’Atlantique . Le poisson provenait de Clyde River, une communauté inuite située sur la côte de l’île de Baffin, sculptée par les glaciers, dans le territoire canadien du Nunavut, à plus de 400 kilomètres au-dessus du cercle polaire. Bien que le saumon de l’Atlantique ne soit pas totalement inconnu des habitants de l’Arctique oriental, le pêcheur qui a capturé ce spécimen l’a trouvé suffisamment remarquable pour le remettre au bureau du ministère de la pêche et des océans à Iqaluit, qui l’a expédié à Mme Dunmall. Elle a reçu plusieurs autres saumons de l’Atlantique au cours des années qui ont suivi et, bien qu’elle ne dispose pas des données nécessaires pour parler de tendance, elle estime que le phénomène mérite d’être exploré.
« Ce que nous constatons dans l’ouest de l’Arctique, c’est qu’il y a plus de saumons du Pacifique, et cela semble être lié aux conditions environnementales », explique-t-elle. « Nous travaillons avec les communautés pour mieux comprendre si le saumon de l’Atlantique suit des schémas similaires et, si c’est le cas, ce que cela pourrait signifier pour l’environnement marin et les récoltes de subsistance.

Si les saumons atlantiques sont effectivement de plus en plus nombreux à s’infiltrer dans l’Arctique canadien, le coupable potentiel est évident : le changement climatique. Les océans de notre planète ont absorbé plus de 90 % de l’excès de chaleur généré par le réchauffement climatique, ce qui a poussé de nombreuses espèces à se déplacer vers des climats plus frais. Les changements les plus spectaculaires se sont produits dans l’Atlantique Nord-Ouest, où des créatures allant du bar noir au poisson beurre ont suivi le littoral de l’Amérique du Nord vers des latitudes plus élevées.
Pour certaines créatures, comme le homard américain, le réchauffement des océans a déjà stimulé la productivité. Le saumon pourrait également bénéficier de conditions plus clémentes en accédant à des eaux arctiques autrefois inhabitables. Les saumons sont de plus en plus nombreux au large de l’archipel norvégien du Svalbard, ce qui amène les chercheurs à penser que les stocks d’Europe du Nord trouvent déjà leur subsistance dans l’Arctique.
Dans l’ensemble, cependant, il est pratiquement certain que Salmo salar finira par souffrir. Dans le sud de la Nouvelle-Angleterre, à la limite thermique de l’aire de répartition du saumon atlantique, les gestionnaires de la pêche ont mis en causele changement climatique dans l’échec de la reconstitution des stocks sur des rivières comme la Farmington et la Connecticut. En Europe, les modèles suggèrent que le saumon pourrait disparaître des bassins fluviaux du Portugal, de l’Espagne et d’une grande partie de la France d’ici 2100, alors que le baliste, la dorade et d’autres nouveaux arrivants apparaissent le long de la côte irlandaise.
« Si vous êtes une espèce d’eau froide, vous ne serez probablement pas très heureux dans une situation où toutes ces espèces d’eau chaude s’en donnent à cœur joie », explique Ken Whelan, directeur de recherche de l’Atlantic Salmon Trust, basé en Irlande. En 2018, le Trust a lancé le Missing Salmon Project, un projet de marquage et de suivi visant à déterminer pourquoi moins de 4 % des saumoneaux qui quittent les rivières du Royaume-Uni rentrent chez eux, soit une fraction des retours historiques. Bien que M. Whelan soit loin d’avoir identifié le problème, il soupçonne le climat d’être une « question primordiale » qui exacerbe les problèmes existants, tels que l’aquaculture et la prédation. « Pour moi, c’est ce qui est le plus inquiétant : ces types d’effets pourraient être cumulatifs », déclare-t-il.
Le saumon est un poisson des deux mondes et le changement climatique risque d’altérer chaque phase de son cycle de vie complexe, de la survie des tacons au succès reproductif des géniteurs. L’accumulation des menaces marines et d’eau douce explique pourquoi, en 2016, les scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis ont déclaré que les poissons diadromes constituaient le groupe d’espèces le plus vulnérable de l’Atlantique Nord-Ouest, et ont placé le saumon en tête de liste.
Malgré les cris d’alarme, la disparition du saumon n’est pas un fait accompli etn’échappe pas à notre contrôle. Les défenseurs de l’environnement prennent déjà des mesures pour rendre les rivières de notre continent plus hospitalières face au réchauffement de la planète. En fin de compte, la survie de l’espèce pourrait dépendre de la capacité de la société à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de la capacité d’un poisson aux ressources légendaires, qui a déjà subi des changements climatiques par le passé, à s’adapter à la version rapide de ces changements provoquée par l’homme et actuellement en cours.
« La question de savoir si le saumon atlantique a une capacité d’adaptation suffisante est une expérience naturelle qui se déroule actuellement », déclare Fred Whoriskey, chercheur de longue date et ancien vice-président de la FSA chargé de la recherche. « Nous devrons voir ce qu’il en est.

Même dans les meilleures conditions, la vie d’un saumon est une succession de menaces. Au cours de millions d’années, les poissons ont évolué pour franchir la course d’obstacles de l’anadromie, leurs gènes étant calibrés pour supporter la migration, échapper aux prédateurs et trouver de la nourriture. À mesure que leur monde se réchauffe, les saumons de l’Atlantique risquent de découvrir que leur physiologie et leur écologie comportementale finement réglées ne leur servent plus à grand-chose
Pour comprendre les défis que pose le changement climatique au saumon atlantique, imaginez que vous êtes vous-même un poisson, peut-être un alevin éclos dans la rivière Miramichi. La Miramichi n’est pas seulement la mère de toutes les rivières à saumon de l’est du Canada, elle est aussi, selon Nathan Wilbur, directeur des programmes du Nouveau-Brunswick à la Fédération du saumon atlantique, « le point zéro des impacts du changement climatique sur le saumon atlantique ». Au nord de la Miramichi, explique M. Wilbur, les rivières canadiennes restent, du moins pour l’instant, constamment froides ; plus au sud, des cours d’eau comme la rivière Penobscot, dans le Maine, dépassent régulièrement le seuil de tolérance du saumon à la chaleur. « La Miramichi est la ligne de démarcation », explique M. Wilbur.
Dernièrement, cependant, la Miramichi a basculé vers l’extrémité chaude du spectre des températures. Ainsi, la première menace à laquelle un alevin, à peine plus long qu’un trombone, peut être confronté dans la Miramichi est la chaleur. Bien qu’un peu de réchauffement puisse vous aider à grandir plus rapidement, vous commencez à vous sentir stressé dès que le thermomètre dépasse 20 degrés. À 23 degrés, vous commencez à chercher des refuges d’eau froide, car votre métabolisme s’accélère et le lactate s’accumule dans vos petits muscles. Si la température de l’eau atteint 28 degrés, il ne vous reste qu’une semaine à vivre ; si elle atteint 33 degrés, vous êtes mort en 10 minutes. En 2018, dit Wilbur, la Miramichi a dépassé les 23 degrés pendant 57 jours, la plupart consécutifs. « Les poissons étaient soumis à un stress incroyable », explique-t-il.

Survivez à l’eau chaude – sans parler des hérons, des harles et des bars, qui sont tous plus difficiles à éviter lorsque vous êtes en léthargie – pendant les phases d’alevinage et de tacon pour devenir un smolt, et vous serez confronté à votre prochain obstacle : la migration vers la mer. À ce stade, le choix du moment est primordial. Si vous atteignez l’océan trop tôt ou trop tard, vous risquez de manquer votre fenêtre d’alimentation optimale, d’entrer en collision avec des prédateurs ou même d’avoir du mal à réguler votre physiologie. Bien que votre départ pour l’océan soit en partie régi par les changements saisonniers de la lumière du jour, la température joue également un rôle majeur. En 2014, des chercheurs ont constaté que le réchauffement des cours d’eau de l’Atlantique Nord au cours des 50 dernières années avait avancé les migrations des saumoneaux de 2,5 jours par décennie. Cela peut sembler subtil, mais lorsque vous êtes un saumoneau affamé et vulnérable, le moindre décalage entre la rivière et l’océan peut s’avérer fatal.
Si tant est que vous parveniez à atteindre l’océan. Dans l’estuaire de la Miramichi, vous serez poursuivi par des bancs de bars rayés voraces, dont le nombre s’élève actuellement à un million, alors qu’il n’était que de 5 000 dans les années 1990. À l’époque, le MPO a fermé toutes les pêcheries de bar rayé du sud du golfe du Saint-Laurent et leur retour est une réussite en matière de conservation. Mais le retour du prédateur s’est avéré problématique. Sur la rivière Miramichi Nord-Ouest, explique Wilbur, le taux de survie des saumoneaux dans l’estuaire a chuté ces dernières années, passant de 70 % à moins de 10 %. Bien qu’il soit impossible d’attribuer entièrement ce déclin au bar, les bars rayés affamés sont, comme l’a écrit le biologiste John Waldman, « une arme très fumeuse ». Et bien que le bar rayé soit originaire de la Miramichi, ces robustes généralistes vivent aussi loin au sud que la Floride, ce qui donne à penser qu’ils pourraient mieux résister à notre avenir brûlant que leurs proies les saumons. « Nous ne pouvons pas dire que c’est dû au changement climatique, mais nous savons que le bar rayé se porte bien dans les eaux plus chaudes », explique Wilbur.
Si vous échappez à l’armada de pêcheurs, félicitations : votre vie est sur le point de devenir encore plus périlleuse. Les perturbations océaniques liées au changement climatique ne sont peut-être pas aussi visibles que les tacons qui flottent le ventre à l’air dans les cours d’eau surchauffés, mais elles n’en sont pas moins insidieuses. Avec le réchauffement des températures, le krill riche en lipides – l’équivalent du cheeseburger au bacon pour le zooplancton – a été supplanté par des copépodes plus petits et moins nutritifs ; contraint de remplir votre réservoir avec un carburant de moindre qualité, votre croissance ralentit et vous restez plus vulnérable aux phoques, aux requins et aux autres prédateurs. Les poux de mer se reproduisent plus rapidement dans les eaux plus chaudes, ce qui augmente votre risque d’infection, en particulier lorsque vous passez à proximité de fermes d’élevage de saumons qui sont des lieux de reproduction pour les contagions. Les schémas océanographiques peuvent se dérégler, le Gulf Stream se renforçant et le courant du Labrador se relâchant, ce qui perturbe la route migratoire inscrite dans votre cerveau. Votre corps à sang froid, entièrement régi par la température ambiante, accélère son métabolisme avec la chaleur, se transformant en l’équivalent piscicole d’une grosse cylindrée.
« Il se peut que vous en arriviez à un tel point que votre alimentation soit consommée à un rythme si rapide que vous ne stockez pas les graisses dont vous avez besoin pour survivre pendant l’hiver », explique M. Whoriskey.
Si, par miracle, vous évitez les prédateurs, supportez les poux de mer et naviguez sur des courants changeants, votre succès reproductif est loin d’être garanti. Deux ans après votre départ, votre Miramichi natale est encore plus chaude qu’elle ne l’était à l’époque du tacon, ce qui met une fois de plus à l’épreuve votre métabolisme hyperactif. Stressé par la chaleur et épuisé, vous êtes susceptible de faire face à des menaces même apparemment mineures, comme une lutte de dix minutes au bout d’un bas de ligne mono effilé. Si vous parvenez enfin à creuser votre trou et à y déposer vos œufs, vos gènes ne sont guère assurés de persister. Les tempêtes de pluie, intensifiées par le changement climatique, peuvent balayer votre future progéniture avant que le cycle ne puisse recommencer.
« Il est extrêmement peu probable que le saumon atlantique en tant qu’espèce s’éteigne globalement au cours des 100 prochaines années » en raison du changement climatique, conclut un rapport de 2017 du Conseil international pour l’exploration de la mer. « Cependant, il est très probable que certaines populations subiront des réductions significatives de leur abondance. » L’extirpation, ou disparition localisée, n’est ni permanente ni aussi dévastatrice qu’une extinction totale. Mais pour les communautés situées aux limites méridionales de l’aire de répartition du saumon atlantique, les pertes n’en seront pas moins définitives.
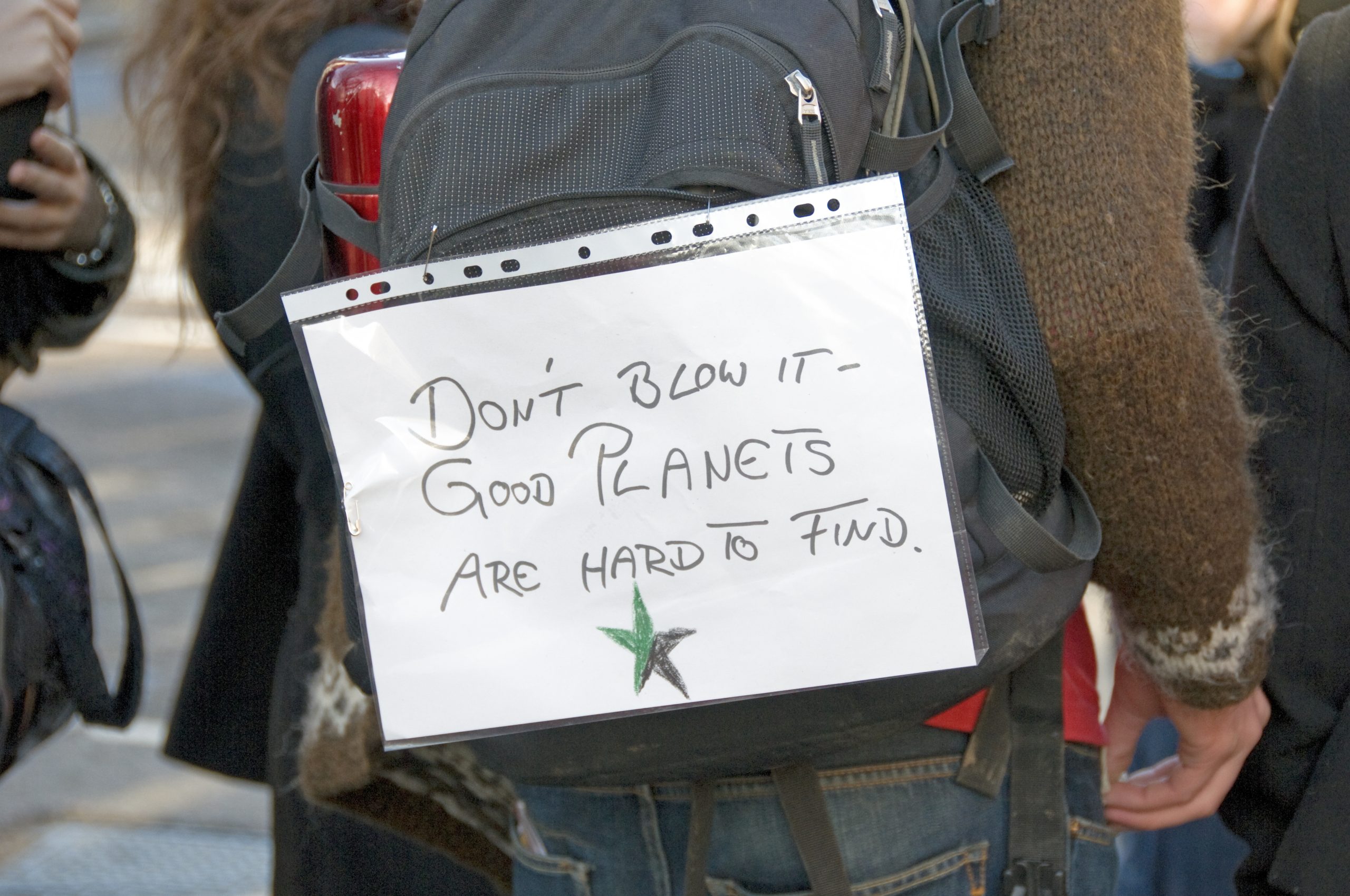
La situation du saumon de l’Atlantique est peut-être désastreuse, mais elle n’est pas désespérée. La rivière Miramichi est parsemée de poches glaciales, de suintements et de ruisseaux alimentés par les eaux souterraines qui se jettent dans le cours principal et créent des bassins qui restent plusieurs degrés plus froids que la rivière environnante. Pour un pêcheur, ces zones froides offrent des trous de pêche attrayants. Pour un saumon, ce sont des bouées de sauvetage.
En 2010, Emily Corey, étudiante en doctorat à l’université du Nouveau-Brunswick, a découvert à quel point ces ports froids peuvent être vitaux. Ce printemps-là, Emily Corey a inséré des étiquettes PIT – des micropuces de la taille d’une pointe de crayon – dans 600 poissons afin de suivre leurs déplacements dans le bassin hydrographique. En juillet, la température de la rivière a dépassé les 26 degrés pendant plusieurs jours et a même brièvement atteint la température mortelle de 31 degrés. En parcourant la rivière à l’aide d’un lecteur d’étiquettes mobile, Corey a constaté qu’il n’y avait pratiquement pas de poissons, jusqu’à ce qu’elle atteigne les précieux points froids. « Là où il faisait le plus frais et le plus profond, c’est là que se trouvaient les adultes », se souvient Corey avec étonnement, « et puis vous avez un nuage de tacons par-dessus le marché ».
Souvent, les tacons de saumon atlantique sont agressifs et défendent farouchement leurs zones d’alimentation contre leurs rivaux. Cet été-là, cependant, ils vivaient en harmonie, adhérant à ce que Corey appelle « un comportement presque scolaire ». En d’autres termes, il était moins important de garder son territoire que de rester au frais. Fait remarquable, certains poissons ont parcouru jusqu’à huit kilomètres pour se mettre à l’abri. « Ils ont trouvé n’importe quelle zone plus fraîche », explique M. Corey.

La protection de ces refuges d’eau froide est aujourd’hui au cœur des travaux de conservation sur la Miramichi, une stratégie d’adaptation cruciale face au réchauffement des cours d’eau. Le ministère des Pêches et des Océans gère la rivière selon un « protocole d’eau chaude », qui protège les poissons adultes qui utilisent les bassins froids pour frayer. Si la température de la rivière dépasse 20 degrés pendant 48 heures consécutives, le MPO ferme 26 refuges d’eau froide à la pêche afin de protéger les saumons d’un stress thermique supplémentaire. S’il fait plus de 23 degrés, les pêcheurs ne sont autorisés à pêcher que le matin. En 2018, au grand dam de certains pourvoyeurs, les bassins d’eau froide ont été fermés pendant près d’un mois et demi, du 5 juillet au 21 août.
Quoi qu’il en soit, les défenseurs de l’environnement et les pêcheurs à la ligne ne se contentent pas de sauvegarder les refuges froids, ils les améliorent. Depuis 2014, la Miramichi Salmon Association a mené à bien neuf projets de restauration des eaux froides, en utilisant de la machinerie lourde pour approfondir les trous, dévier les débits de l’embouchure des ruisseaux vers le courant principal et installer des rochers pour rendre les fosses froides encore plus attrayantes. Une gestion forestière plus intelligente peut également s’avérer utile. La protection des forêts dans le cours supérieur du bassin versant de la Miramichi et le maintien de larges zones tampons riveraines autour des cours d’eau ralentissent le ruissellement après les tempêtes de pluie, réduisant ainsi l’érosion et permettant à l’eau froide de rester plus longtemps dans la rivière. « Nous ne pensons pas que les réglementations forestières soient suffisamment strictes pour protéger les eaux froides et les débits », déclare M. Wilbur.
Malgré toute leur valeur, ces décisions locales d’utilisation des terres n’ont qu’une portée limitée. Dans une étude de 2016 qui a analysé quatre décennies de données, les chercheurs ont constaté que les changements dans l’utilisation des terres, comme le surpâturage des moutons, avaient peu d’impact sur la survie en eau douce du saumon de l’Atlantique et de la truite brune dans le bassin hydrographique de Burrishoole, en Irlande. Ce qui compte, c’est le climat. Les années où les hivers étaient plus humides et plus chauds – des conditions qui deviendront de plus en plus courantes à mesure que le climat changera – les salmonidés ont connu des taux de survie plus faibles.
Bien entendu, les modifications de l’utilisation des terres ne contribuent guère à la protection du saumon en mer, alors que ce dernier est soumis à un éventail stupéfiant de facteurs de stress liés au climat, que nous comprenons encore à peine. « Nous devons nous répéter que le saumon n’est pas un poisson d’eau douce », déclare M. Whelan. « Nous devons considérer ces créatures comme des poissons marins et nous asseoir avec les scientifiques qui étudient le hareng, le maquereau et d’autres stocks pélagiques pour voir ce qu’ils nous racontent.
Cette histoire : Le changement climatique non maîtrisé pourrait bien, en fin de compte, avoir raison de nos efforts de conservation. Selon la quatrième évaluation nationale du climat, un rapport volumineux publié en 2018 par le gouvernement américain, le monde connaîtra un réchauffement de deux à trois degrés d’ici la fin du siècle, même si nous parvenons à réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Et bien que presque toutes les nations du monde aient signé les Accords de Paris, un accord de 2016 visant à réduire les émissions mondiales, les pays industrialisés ont fait peu de progrès pour atteindre les objectifs de l’accord – qui, selon de nombreux chercheurs, ne seraient de toute façon pas suffisants pour maintenir le réchauffement en deçà de deux degrés. Et ce, avant que le deuxième plus grand émetteur de carbone, les États-Unis, ne se retire des accords en 2017.
S’il existe un espoir à long terme pour Salmo salar, il réside dans la ténacité éprouvée du saumon face aux changements environnementaux. L’espèce a déjà surmonté les fluctuations entre une période glaciaire et une ère successive de réchauffement climatique. Le saumon de l’Atlantique envoyé à Karen Dunmall pourrait-il être le signe que le Salmo salar trouvera à nouveau le moyen de survivre ?
Seul le temps nous le dira, mais en attendant, il est essentiel de comprendre l’étendue de l’aire de répartition septentrionale du saumon et d’identifier et de protéger les zones où se trouvent des sources froides et des cours d’eau ombragés. À mesure que l’Arctique devient plus habitable, les interventions humaines visant à préserver et à améliorer les refuges d’eau froide pourraient permettre au saumon atlantique de survivre et, peut-être, de prospérer à nouveau un jour. Ce serait génial.